Bien qu’il soit utilisé depuis la plus haute antiquité, le plâtre est mal connu. Peut-être est-ce dû à son utilisation qui resta localisée, pendant des siècles, à proximité des carrières de gypse. Peut-être aussi parce qu’il est réputé fragile, facilement dégradé par l’eau… Pourtant, il n’est est rien : bien employé, il peut devenir extrêmement dur et résistant. Seulement voilà : il relève de savoir-faire précis.
Le plâtre est obtenu par la calcination lente du gypse, sulfate hydraté de calcium naturel.
C’est un matériau sain. Malheureusement, sous la pression croissante des contraintes environnementales sur les sites de production, le gypse de carrière risque d’être progressivement remplacé par les gypses synthétiques : phosphogypse, sulfogypse, titanogypse, borogypse…
À la cuisson, le gypse perd ses molécules d’eau et devient plâtre qui sera broyé et tamisé.
Sur le chantier, l’eau de gâchage lui restitue ces molécules perdues. Le plâtre redevient alors du gypse, aussi dur que de la pierre.
On comprend donc aisément qu’un plâtre naturel non “adjuvanté” soit un matériau intégralement et éternellement recyclable. Si, lors de travaux, vous rencontrez ce type de plâtre, ne jetez rien! Il vous suffira de le recuire pour pouvoir l’utiliser à nouveau.
Un des plâtres qui se rapproche le plus de ces plâtre anciens est le plâtre gros. Il tire son nom de sa mouture grossière.

Le plâtre gros est encore utilisé aujourd’hui pour les enduits extérieurs qui ne doivent jamais être réalisés au plâtre fin. En effet, ce dernier donne des enduits poreux, sensibles à l’humidité, qui, en faisant gonfler le plâtre provoque sa désagrégation. Vous connaissez certainement ces enduits sous le nom de “enduit du Marais” car c’est ainsi qu’étaient réalisées les façades des anciens immeuble de ce quartier de Paris. Le plâtre gros est encore produit dans la région parisienne. Il convient d’utiliser uniquement du plâtre gros de construction (P.G.C.) conforme à la norme NF en cours, et fabriqué sans aucun adjuvant.

Traditionnellement, la formulation de l’enduit est la suivante :
– 1 volume de chaux aérienne
– 2 volumes de sable
– 3 volumes de plâtre gros
On peut faire varier la composition de cette formule de base en augmentant la proportion de chaux par rapport à celle du plâtre (avec l’inconvénient d’une mise en œuvre plus difficile) pour obtenir des mortiers plus souples en fonction des supports. On peut aussi augmenter la proportion de sable pour la couche de finition selon la qualité et l’aspect souhaités.
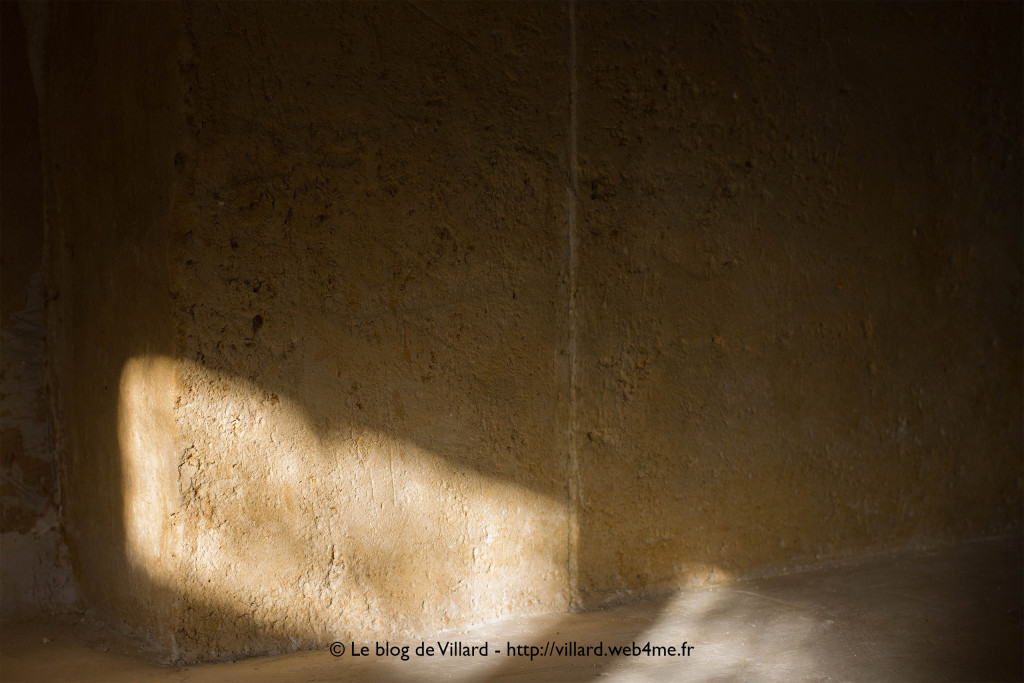
Outre les enduits extérieurs, les applications du plâtre gros sont nombreuses : additionné de colorants naturels ou artificiels (attention à la tenue des couleurs aux UV et dans le temps), de sables colorés, de végétaux (paille, osier, chanvre, sciure, copeau…), brique pilée, nacre de coquillage suivant l’esthétique ou les contraintes mécaniques à obtenir, la liste n’est pas limitative.


Bonjour, j’aimerai avant isolation d’un mur intérieur qui est en pierre tout venant et joint ancien passer une couche de plâtre pour aplanir ce mur. Je possède 15 sacs de plâtre gros, ce matériaux ira-t-il ?
Que me conseillez vous pour l’application , en 1 seule passe ? ou un gobetis et une seconde passe ?
il y aura maxi 5mm sur la pierre et 15mm sur les joints.
Merci de cette information
Bonjour, tout dépend de votre isolation. Le plâtre va laisser le mur respirer et rester dans la logique de la maçonnerie ancienne. Si vous bloquez ensuite les échanges hygrométriques avec une isolation peu respirante vous concentrerez des problèmes qui ne deviendront perceptibles que quand il sera trop tard. Et pour le gobetis, qui n’est qu’une couche d’accrochage dans les maçonneries de ciment, c’est ici absolument inutile.
BONJOUR M VILLARD.
MERCI DE VOS CONSEILS.
J UTILISE CHAUX AERIENNE PLATRE GROS ET MAP. POUR FUXER LES FTNETRES PVC ..
RESULTAT IMPECCABLE. HYPER SOLIDE.
JE FIXE PRÉALABLEMENT LES CADRES DE FENETRE AVEC DES VISSES.
RICHARD
Merci pour cette information.
pour un enduit intérieur peut on aussi utiliser du plâtre gros?
Bonjour, vous pouvez surtout utiliser les enduits plâtre gros en intérieur. Il ne seront pas lessivés par les intempéries comme en extérieur. En revanche, nécessité de bien maîtriser la technique du plâtre et de faire des essais pour la finition (ferrée, grattée…)
Bonjour Monsieur Villard,
Je voudrais realiser cet enduit chaux platre, sur une cloison en brique enduite de platre, comment savoir si ce platre est du platre gros ou fin ?, et si il sera compatible? ce support date environ des annees 1960.
Merci pour votre blog et votre reponse.
Isabelle
Bonjour, pour le savoir il faudrait l’analyser mais je ne pense pas que dans les années 1960 on pouvait se procurer du plâtre gros (années glorieuses du ciment et des matériaux pré-fabriqués). Mais cela ne posera pas de problème : si votre support plâtre/brique est stable, qu’il ne poudre pas et ne se détache pas, vous pourrez faire tenir votre enduit sans problème. Pensez juste à bien humidifier le support. Et faîtes attention aussi : cet enduit tire très vite à l’application.
super! merci! super clair.
😀
Bonjour Monsieur VILLARD :
Il y a une erreur sur cette norme
NF B12-301 Décembre 1987
B12-301
ANNULÉE le 17/01/2009
Gypse et plâtre – Plâtres pour enduits intérieurs à application manuelle ou mécanique de dureté normale ou de très haute dureté – Classification, désignation, spécifications.
Elle s’applique aux plâtres destinés à la réalisation d’enduits intérieurs de murs et plafonds par application manuelle ou mécanique, répondant à la définition du DTU n° 25.1.
Je n’ai pas celle qui la remplace et vous?
Bonjour, oui effectivement, merci de me le signaler. Je vais modifier l’article et mettre un terme plus générique qui anticipera les futurs changements… La nouvelle norme semble être la NF EN 13279-1 Novembre 2008, et la NF EN 13279-2 Février 2014. Pour se les procurer, je pense qu’il n’y a pas d’autre solution que de passer par le site de l’AFNOR : https://www.boutique.afnor.org/recherche/resultats/mot/NF%20EN%2013279
Bonjour
Ou pourrais je trouver du plâtre gros?
J’habite dans l’Oise (60) et chez tous les enseignes de matériaux ou j’ai cherché ils n’en ont pas (souvent ils ne savent même pas ce que c’est)
J’arrive à trouver de la chaux aérienne parfois.
Est-ce que on peut commander par internet ?
Il y a 20 ans j’avais refait des encadrements de fenêtre avec le mélange 3,2,1, (plâtre gros / sable et poussière de pierres / chaux et j’ai à nouveau des travaux.
Sans plâtre gros cela semble compromis ?
Bonjour,
J’ai eu le même souci il y a quelques semaines et finalement, j’ai réussi à en trouver chez Point P.
La référence :
https://www.pointp.fr/p/platre-isolation-ite/platre-manuel-gros-sac-de-40-kg-A1173963
Réf. Point.P : 1173963
Ref. SINIAT : 95829
Je pense que vous en trouverez sans problème dans l’Oise.
Et oui, sans plâtre gros vous êtes coincé car il faut du gypse pur avec un liant aérien (chaux CAEB) pour ce type de mortier/enduit.
J’espère que je vous ai aidé.
j’ai piqueté un mur intérieur gorgé d’eau, je vaudrais le replatrer à l’ancienne,celui-ci était mon métier. mais j’avoue ne pas connaitreet les dosage de platre gros’de sable,et de chaux aérienne et le dosage en eau.la durée de gachage est de combien de temps
Bonjour Christophe, vous trouverez toutes ces informations dans l’article sur le plâtre gros. Ce sont des dosages indicatifs qui peuvent être modifiés en fonction de votre expérience et de ce que vous recherchez. En ce qui concerne le gâchage, la prise se fait très rapidement quand on n’a pas noyé le mélange. Et faites attention quand même à bien mettre le mur définitivement hors d’eau et à le laisser sécher avant de refaire votre enduit 😉
Bonjour,
je reprends mes tours de fenêtre au plâtre gros après avoir réalisé un enduit chaux-chanvre qui a donné plus d”épaisseur à ma façade. Je ne sais pas si c’est normal, mais je suis obligé de procéder par très petites quantités et je suis surpris par le temps qu’il faut pour préparer une nouvelle fournée. En revanche, j’ai à peine le temps de travailler avant que le mélange ne prenne. Y a t-il une astuce ?… je cherche des conseils avisés pour un débutant.. Merci d’avance.
Bonjour Henri, je vous ai répondu par email.